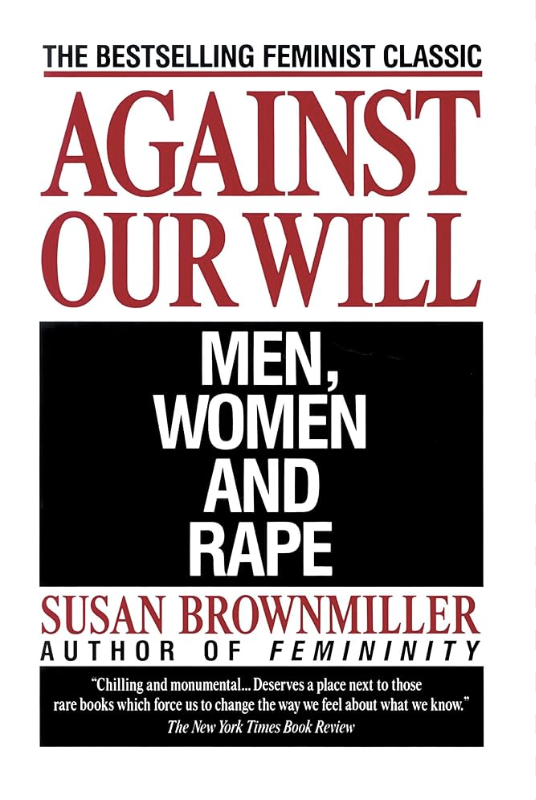Comprendre les rouages de la culture du viol
La semaine dernière, une vague de témoignages a déferlé sur les réseaux sociaux.
Des dizaines de femmes ont brisé un silence parfois vieux de plusieurs années pour raconter ce qu’elles avaient subi : attouchements imposés, viols, harcèlement. Certaines ont écrit pour la première fois. D’autres ont déjà parlé, mais n’ont jamais été entendues. Les noms des agresseurs circulent, les récits s’accumulent et ce qui pourrait sembler être un choc passager confirme une nouvelle fois que les violences sexuelles sont systémiques. Elles trouvent refuge dans un terreau culturel, social et institutionnel qui dépasse largement les agresseurs.
Comprendre ce système, c’est comprendre comment des blagues, des clichés médiatiques, des silences complices et des choix politiques forment ensemble un environnement où ces violences deviennent possibles et bien souvent, sans conséquences.
Les racines de la culture du viol
La “culture du viol” n’est pas un slogan militant flou. C’est une grille d’analyse qui dévoile comment des pratiques, des discours et des silences construisent un terrain favorable aux violences sexuelles. Popularisée dans les années 1970 par Susan Brownmiller, l’expression replace le viol dans sa dimension sociale et politique, et montre comment les rapports de pouvoir façonnent les corps, les comportements et les récits.
Cette culture prend racine dans un ensemble de codes, de symboles et de réflexes, parfois imperceptibles, qui influencent notre perception du consentement, du corps et du genre. Parmi eux, la culture de la pureté occupe une place centrale : elle érige la virginité et l’innocence en vertus morales absolues, faisant de la sexualité féminine un capital moral à préserver. Transgresser cette norme revient à perdre de la valeur et, trop souvent, à être tenue pour responsable des violences subies.
Le premier socle de ce terreau, c’est l’éducation genrée. Dès l’enfance, les filles apprennent la prudence, la retenue, la vigilance ; les garçons, eux, voient leur audace valorisée et leur insistance excusée. Ce double standard ne façonne pas seulement des comportements : il installe des attentes collectives sur qui peut dire “non” et qui peut continuer à insister. Dans les faits, la responsabilité du consentement repose sur les filles, tandis que l’agresseur est blanchi par des excuses vaines comme “le désir masculin” ou les “erreurs de jeunesse”. Or, 80 % des agressions sexuelles sont commises par des personnes connues de la victime, rendant la dénonciation, judiciaire ou publique, d’autant plus difficile.
Ce climat est renforcé par une accumulation de micro-violences : blagues sexistes, remarques sur la tenue, gestes intrusifs banalisés. Dans les films ou les chansons, l’insistance masculine est romantisée : le “non” est ambigu, voire désirable.
Ces gestes répétés construisent un continuum où la transgression devient tolérable, puis attendue. Les recherches sur les “rape myths” (mythes qui blâment la victime ou excusent l’auteur) montrent que plus ces récits sont médiatisés, plus ils sont perçus comme normaux.
Mais au-delà des blagues et de la banalisation, la culture du viol est profondément ancrée dans la misogynie structurelle. Elle s’appuie sur des traditions culturelles (comme la dot ou les certificats de virginité) qui deviennent malgré elles, un gage implicite de virginité, une “garantie” qui assimile la valeur d’une fille à la préservation de son corps pour un futur mari. Ce système enferme les femmes dans une logique de propriété et de contrôle, où la sexualité féminine n’appartient pas à la femme elle-même.
À cela s’ajoutent des stéréotypes patriarcaux enracinés en tous. Cette logique opère lorsqu’on qualifie les femmes “d’émotives” ou de “dramatiques”, décrivant leurs paroles comme excessives et leur mémoire comme peu fiable. Ces stéréotypes sont des armes rhétoriques : ils permettent de semer le doute sur toute dénonciation, de justifier l’attente de “preuves” irréalisables, et donc de maintenir l’impunité.
Autre racine : la fabrication du doute autour de la parole des victimes. Trop souvent, le premier réflexe est de relativiser : “c’était l’alcool”, “ils se sont mal compris”, “vous exagérez”. Ces justifications déplacent l’attention : au lieu d’examiner la violence, on cherche des circonstances atténuantes. Les médias, les entreprises, les proches et même les institutions judiciaires participent à cette fabrique du doute ; qu’il s’agisse de cadrages médiatiques partiaux, de stratégies de défense agressives ou de procédures internes opaques.
Résultat : moins de 10% des victimes déposent plainte et parmi elles, moins de 1% aura gain de cause. Le parcours judiciaire est un chemin semé d'embûches. Cette dissuasion systémique renforce l’idée que parler ne sert à rien ou met en danger.
Enfin, la culture du viol prospère sur les réseaux de pouvoir. Dans le monde du travail, les milieux artistiques, les cercles politiques, amicaux et familiaux, protéger la réputation et le statut quo prime souvent sur la sécurité des victimes. Les agressions sont traitées comme des “dommages collatéraux” tant que l’ordre économique ou social n’est pas menacé. Ainsi, l’agresseur continue d’agir ; la victime, elle, est isolée, et voire rejetée lorsqu’elle brise le silence.
L’écosystème du silence : comment la société protège les violeurs
La culture du viol ne repose pas uniquement sur les agresseurs. Elle se nourrit du silence de ceux qui choisissent de fermer les yeux par confort, par loyauté ou par peur. Amis, famille, collègues, médias, institutions, justice : chacun joue, consciemment ou non, un rôle dans la protection des auteurs. Cette toile de silences transforme un acte individuel en impunité collective. Ce qu’on appelle communément la “trahison institutionnelle” (institutional betrayal) n’a rien d’une image : c’est le constat que les organisations censées protéger les individus (écoles, entreprises, fédérations, services publics) aggravent parfois le traumatisme en minimisant ou étouffant les faits.
Dans la sphère privée, les réseaux personnels deviennent la première ligne de défense des agresseurs. Quand l’accusé est un ami, un collègue ou un proche, la pression sociale pousse à minimiser : “il n’est pas comme ça”, “c’est impossible”. Psychologiquement, on diffuse la responsabilité ; on préfère préserver un équilibre relationnel plutôt que de risquer le conflit. L’affaire des viols de Mazan illustre bien cela : malgré des preuves accablantes, plusieurs accusés ont été soutenus par leurs épouses et amis, leur image de “monsieur tout le monde” pesant plus lourd que la parole de la victime.
Les institutions ajoutent ensuite leur propre couche de protection, souvent sous couvert de “neutralité”. Universités, entreprises ou structures culturelles disposent de mécanismes internes qui servent à contenir le scandale : enquêtes opaques, accords de confidentialité, mutations discrètes. Les promesses d’action sont suivies d’inaction, parfois même de représailles contre la personne qui parle. En France, la lenteur judiciaire, les classements sans suite et les délais de prescription nourrissent l’idée que dénoncer est coûteux, incertain et dangereux.
Résultat : 94% des violeurs ne sont jamais condamnés et 86% des viols signalés sont classés sans suite. Même lorsque l’affaire arrive devant un tribunal, les victimes affrontent des interrogatoires humiliants, des expertises biaisées par le sexisme et le racisme, et des délais interminables. Beaucoup renoncent, épuisé.e.s et/ou traumatisé.e.s à nouveau.
Mais la défaillance et l’impunité ne se limitent pas aux tribunaux : elle se prolonge dans la vie quotidienne. Lorsqu’un agresseur reste libre et intègre sans difficulté des cercles sociaux, culturels ou professionnels, il reçoit un message implicite : son acte est toléré et la culture du viol continue. Plus grave encore : cette tolérance collective encourage la récidive. Si les agresseurs continuent d’agir ainsi, parce que la société leur laisse des espaces et des moyens de sociabiliser, des possibilités de nouer des relations. L’impunité se nourrit des accolades, des invitations, des collaborations offertes à ceux qui devraient être bannis. Un agresseur qui reste dans le cercle social ne perd rien : il garde sa crédibilité, son pouvoir, son accès à de futures victimes.
Le problème est que la loi, seule, ne peut pas démanteler la légitimité sociale de l’agresseur. Une condamnation pénale, quand elle existe, ne change rien si la personne peut revenir sur un plateau télé, animer un festival, enseigner à l’université, être invitée à des dîners, continuer à réseauter. Cette absence de sanction sociale est une seconde gifle pour les victimes : elle les force à croiser leurs agresseurs dans les mêmes espaces, à voir ces derniers célébrés, parfois même présentés comme des artistes, penseurs ou leaders d’opinion.
Les réseaux sociaux regorgent d’exemples : personnalités accusées ou condamnées qui continuent à se produire sur scène, à vendre des livres, à être soutenues par leurs pairs. Ce que l’on appelle pudiquement “séparer l’homme de l’artiste” devient, en réalité, un mécanisme de blanchiment social qui transforme la gravité du crime en simple “polémique”.
Il est donc primordial de sanctionner aussi socialement. Cela signifie, avant tout, exclure les agresseurs des espaces de sociabilité : ne plus les inviter à des événements, ne pas leur offrir de tribune médiatique, et refuser toute collaboration professionnelle avec eux. Cela implique également de leur retirer toute position d’autorité : un professeur condamné et/ou accusé de violences sexuelles ne doit pas continuer à enseigner, tout comme un programmateur mis en cause ne doit pas pouvoir gérer des artistes ou décider de programmations. La sanction sociale passe aussi par le boycott économique : ne pas financer, consommer ou promouvoir le travail d’un agresseur.
Enfin, la sanction nécessite de formaliser une éthique collective claire : les associations, les collectifs et les institutions doivent inscrire noir sur blanc dans leurs statuts qu’ils refusent toute collaboration avec des agresseurs, même en l’absence de condamnation judiciaire formelle,surtout lorsque les témoignages sont multiples et cohérents. Ce principe ne vise pas à remplacer la justice pénale, mais à occuper le terrain de la protection des victimes et de la rupture du pouvoir social des agresseurs, un terrain trop délaissé.
L'exclusion et le boycott ne sont pas seulement des choix moraux mais des gestes de luttes qui incombent tout autant au public. C’est affirmer que nos lieux de vies, nos scènes, nos espaces culturels, nos lieux de travail et de création ne seront pas des refuges pour ceux qui détruisent des vies. Les agresseurs peuvent échapper au tribunal, mais n’échapperont pas à notre mémoire, ni à notre refus collectif de vous offrir un espace où la parole des victimes peut résonner sans être étouffée par le vacarme de leurs agresseurs.
En bref : ne rien faire, c’est réhabiliter.
Et réhabiliter, c’est prolonger la violence. La sanction sociale est un outil de protection car elle coupe l’agresseur de ses leviers de pouvoir et réduit son accès aux potentielles victimes. Cette responsabilité ne repose pas uniquement sur les institutions, les associations ou les collectifs : elle appartient aussi à chacune et chacun d’entre nous. En tant que public, nous avons un pouvoir immense, souvent sous-estimé. Les billets que nous achetons, les places que nous réservons, les vidéos auxquelles nous accordons notre temps, chaque achat d’un livre ou d’un album contribue à maintenir un agresseur dans la lumière et à nourrir son pouvoir. Refuser de nous rendre à leurs concerts, expositions, projections, conférences ou spectacles, c’est leur retirer le public qui légitime leur présence. La sanction sociale montre publiquement que le crime a et doit avoir des conséquences concrètes sur la vie quotidienne des agresseurs.
Rappelons-le : l’omerta est un feu vert. Ne rien faire, c’est tenir la porte ouverte. Et tant que la porte est ouverte, les agresseurs entrent, s’installent et recommencent.
Agir pour ne pas être complice : stratégies militantes et devoirs collectifs
Si nous voulons démanteler la culture du viol, il faut passer d’une posture d’indignation à une politique active d’interruption de la complaisance. Agir, ce n’est pas simplement “soutenir les victimes” en paroles ; il faut se dire que collectivement il faut changer nos comportements, et nos choix quotidiens et nos institutions pour que les agresseurs perdent le terrain sur lequel ils prospèrent. Il faut briser la chaîne à nos échelles, maillon par maillon, et la chaîne ne se rompt pas seulement en haut, dans les tribunaux : elle se rompt dans chaque cercle social, chaque espace de pouvoir, chaque micro tendu.
Première bataille : l’éducation.
La lutte contre la culture du viol commence dès l’enfance. On doit apprendre que le consentement n’est pas une option, que le corps d’autrui n’est pas une zone libre, que “non” veut dire “non”, et que le silence n’est jamais un “oui”. Les écoles et les parents doivent enseigner ces règles comme on enseigne à lire et à compter. À l’école, au collège, au lycée, ce message doit être martelé, répété, inscrit dans la mémoire des enfants. Les adultes doivent se former eux-mêmes : les juges, les médecins, les journalistes, les professeurs, les artistes, les boulangers, les techniciens.. tout le monde. Car des forces de l’ordre qui doutent de la parole d’une victime, un juge qui s’appuie sur des clichés sexistes, ou un médecin qui minimise une agression, participent directement au maintien du système.
Deuxième bataille : couper l’accès au pouvoir.
Un agresseur ne doit pas garder la main sur des espaces où il peut dominer, influencer ou enseigner. Qu’il s’agisse d’une salle de classe, d’un bureau, d’un plateau télé ou d’une scène, toute position d’autorité doit lui être retirée dès lors que les accusations sont portées. Attendre un verdict définitif, dans un système judiciaire où 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite, revient à laisser le champ libre à la récidive. Les institutions doivent choisir : protéger leur réputation ou protéger les victimes. Il n’y a pas de neutralité possible ou d’attente “de voir si ça se tasse”.
Troisième bataille : soutenir les victimes sans conditions.
Soutenir les victimes, c’est plus qu’exprimer de la compassion. C’est agir, protéger, relayer leur parole, et surtout résister aux réflexes qui nous poussent à relativiser dès que l’accusé est quelqu’un que nous connaissons, que nous admirons, ou que nous avons aimé. La culture du viol prospère précisément sur ce biais de l’incapacité collective et individuelle à croire qu’une personne “si talentueuse”, “si gentille”, “si engagée” puisse commettre l’irréparable. Il faut comprendre que cet affect, cette image que nous avons de l’agresseur présumé est un écran. Il brouille notre jugement et nous pousse à chercher des excuses, à minimiser, à reporter le doute sur la victime. Un agresseur n’est pas seulement un monstre “hors de l’humanité”, mais il peut être un proche, un mentor, un collègue, un ami. Soutenir les victimes, sans condition, c’est accepter de mettre notre attachement, nos souvenirs, notre admiration de côté, et de regarder les faits en face et se rappeler qu’un sourire, une œuvre magnifique, un engagement public, ne lavent pas le crime.
Le soutien inconditionnel signifie que, même lorsque l’accusé est quelqu’un qui nous est cher, nous plaçons la sécurité des victimes et le droit à la justice au-dessus de nos émotions. C’est ainsi que ce soutien inconditionnel peut se prolonge en un choix politique où nous pouvons nous organiser afin de créer et pérenniser des espaces sûrs, féministes, physiques ou digitaux où il est possible de déposer un témoignage sans être soupçonnée, minimisée ou culpabilisée. Entre autres des cellules d’accueil spécialisées, avec des juristes et des psychologues formés aux violences sexuelles. Des espaces sûrs qui puissent garantir la confidentialité et la sécurité de celles et ceux qui témoignent, et d’éviter les représailles et l’isolement social.
Quatrième bataille : rendre la complicité visible et coûteuse.
La culture du viol ne se maintient pas seulement grâce aux agresseurs, mais grâce à ceux qui les protègent, les défendent, font semblant de ne pas voir, tentent de décrédibiliser ou relativiser les témoignages des femmes. Ces gestes complices doivent être nommés et mis en lumière comme on met en lumière les crimes : ce sont des rouages du même système.
Cinquième bataille : impliquer les hommes.
Pas comme figurants, mais comme acteurs de la lutte. La lutte contre la culture du viol ne peut pas reposer uniquement sur les femmes. Les hommes sont les auteurs de ces agressions. Les impliquer passe autant par refuser de rire aux blagues sexistes que de contredire publiquement les propos qui minimisent les violences ou d’interrompre une situation dangereuse au lieu de détourner le regard. Nous devons comprendre une chose essentielle : chaque espace laissé à un agresseur est un terrain où il peut continuer d’agir. Tant que nous ne reprenons pas ces espaces, ils continueront à les exploiter. Le jour où un agresseur ne trouvera plus de scène, plus de chaise, plus de main tendue, c’est là que l’on pourra dire que le cycle commence à se briser.
En somme, la lutte ne se gagne pas uniquement dans les tribunaux : elle se gagne dans nos réseaux, nos dîners, nos programmations artistiques, nos collaborations professionnelles, nos cercles proches, nos foyers et nos indignations.
Notre engagement
Nous le disons sans condition : nous croyons les victimes d’agressions sexuelles. Nous croyons les femmes qui parlent, nous croyons les femmes qui hésitent, nous croyons les femmes qui se taisent. Nous savons que parler est dangereux, coûteux, parfois impossible.
À celles qui n’osent pas encore : vous n’êtes pas seules. Dans la mesure du possible, confiez-vous à une femme de confiance, une amie, une sœur, une collègue. Parlez-lui. Ne portez pas seule le poids de la violence qu’on vous a injustement infligée. Même si le monde ne vous croit pas encore, nous, nous vous croyons. Nous sommes nombreuses, nous sommes là. Aucune d’entre nous ne devrait affronter cette lutte en solitaire. C’est dans nos solidarités féministes et nos vigilances que résident nos forces.